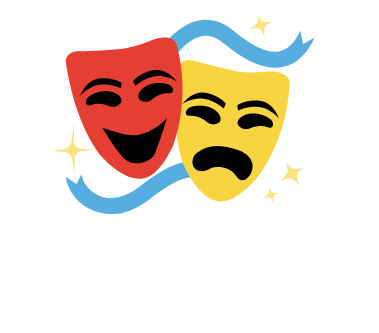Il est rare qu’une pièce soit un phénomène avant même son ouverture, mais Une petite vie c’est exactement ça. L’obsession et la controverse entourant le roman de Hanya Yanagihara de 2015 sur lequel il est basé signifient que les gens se présentent après avoir lu le tome de 720 pages comme une bible. D’autres sont attirés simplement par le fait que James Norton de Vallée heureuse la renommée est en tête.
En arrivant, nerveusement, à l’adaptation scénique de trois heures et quarante minutes d’Ivo van Hove n’appartenant à aucun fan-base, je ne savais pas à quoi m’attendre. Mais je suis reparti ébranlé et remué par une production qui est une description aussi captivante et précise des effets à long terme des abus que vous pouviez vous attendre à voir – même si je doutais encore un peu si j’avais voulu la voir du tout.
Mettre tout simplement, Une petite vie est l’histoire de Jude St Francis (Norton), un avocat de New York, dont l’éducation a été si horrible qu’il ne peut partager aucun fait ou sentiment avec son groupe d’amis fidèles et aimants (un acteur, un peintre et un architecte, joué par Luke Thompson, Omari Douglas et Zach Wyatt respectivement). Il ne peut parler ni à son père adoptif (le bénin Zubin Varla) ni à son assistante sociale (Nathalie Armin) ni à son médecin (Emilio Doorgasingh). Son seul soulagement vient de se couper avec un rasoir – quelque chose que nous voyons tôt et à plusieurs reprises, de grands jets de sang de scène recouvrant le sol rouge et nécessitant un nettoyage répété de l’espace de vie minimal de Jan Versweyveld.
Je n’envie pas le public assis sur scène, si proche de la violence. Mais à certains niveaux, les descriptions de l’horreur graphique de la production de van Hove (des gens qui s’évanouissent et abandonnent leur siège) ont été exagérées. Une grande partie de la violence est stylisée – les films qui tournent en boucle sur les murs deviennent flous, les lumières deviennent jaunes maladives – mais son impact imaginaire est d’autant plus grand qu’il est retenu.
Bien que nous voyions Jude allumer sa main et courir nu autour de la scène dans une terreur abjecte, c’est l’acharnement absolu du traumatisme qui est si insupportable et si bouleversant. Un enfant orphelin qui subit des abus sexuels, l’emprisonnement et les prédilections d’un sadique, c’est un miracle que Jude atteigne même l’âge adulte. En adaptant le roman avec Yanagihara et Koen Tachelet, van Hove se concentre moins sur les amis que sur les injures dont Jude lui-même est victime, mêlant son passé à son présent dans une série de boucles mémorielles, à l’image des cercles dans lesquels il est contraint de courir. Vers la fin, lorsque Yanaghira inflige encore plus de souffrances à son saint héros, tout devient un peu idiot. Pas étonnant que le roman ait été accusé d’être du porno traumatique.
Sur scène, où il y a moins de place pour que les personnages s’épanouissent, c’est encore plus intense. Ce qui retient l’attention, c’est l’intensité des performances. En tant que Jude, décrit comme « un magicien dont le seul truc est la dissimulation », Norton est non seulement engagé mais aussi subtil. En raison de la structure de la pièce, il doit passer en un clin d’œil d’un New-Yorkais sophistiqué et posé extérieurement à un enfant effrayé et pleurnicheur. Il doit jouer angoissé et caché. Il doit chanter Mahler et être rongé par la culpabilité. Il fait tout cela avec une conviction absolue. Au fur et à mesure que l’action progresse, ses vêtements restent ensanglantés, comme si le contenu de son âme avait finalement été exposé, et Norton permet à Jude de se décongeler un peu, suggérant constamment l’agonie sous la douce brillance.
Il est soutenu par une distribution uniformément fine, expliquant les événements à la fois les uns aux autres et au public. Thompson est particulièrement impressionnant dans le rôle du gentil Willem dont l’amour et les soins pour Jude offrent un aperçu du salut. Le moment où ils dansent ensemble a été le seul moment du spectacle où je me suis senti ému aux larmes. Elliott Cowan donne aux agresseurs de Jude leur propre goût du mal – du père Luc insinuant au psychopathe Dr Traylor en passant par le vicieux Caleb.
Van Hove, qui a adapté cette version en langue anglaise d’une première parue en néerlandais, garde une poigne si serrée qu’il est impossible de se détourner, plongeant dans le mal avec une puissance féroce et propulsive. À la fin, j’ai senti que j’avais été témoin d’une description terrible et véridique des effets continus de la capacité de cruauté de l’humanité. Je me demandais toujours pourquoi je voulais plonger si profondément, mais il n’y a aucun doute sur la puissance de la production – ou sur la croyance et l’excellence de tous les acteurs.
…
…