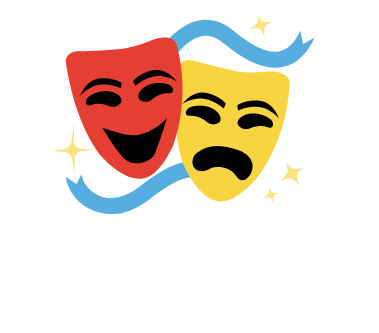À trois mille trois cent vingt kilomètres de l’Irak, Darlee, huit ans, savoure un dîner McDonalds avec son père irakien – il n’y a pas de plus grand symbole de l’Occident que celui des grandes Arches d’Or bien sûr.
Jasmine Naziha Jones écrit et joue dans sa première pièce à la Royal Court. C’est une exploration de la distance entre un père et sa fille ainsi que la distance entre un homme et sa patrie bien-aimée mais déchirée par la guerre. Voir les invasions de l’Irak et les horreurs de l’occupation à travers les yeux d’un observateur impuissant mais émotionnellement investi a tout le potentiel d’être un drame déchirant et désespéré. Malheureusement, Jones a jonché la pièce d’une telle cacophonie de concepts différents que la confusion du genre et de l’histoire est trop importante pour permettre un lien réel avec le matériau.
Conjurer les souvenirs du père et de la fille est un trio qui fait partie d’un chœur grec et d’une présence surnaturelle qui manipule le physique et expose le psychologique. Souad Faress, Hayat Kamille et Noof Ousellam peignent ces apparitions spirituelles à grands traits grotesques. Ils sont irrévérencieux et grossiers et choquants à chaque tournant, en particulier lorsque de véritables aperçus poignants se font jour – c’est cette vulgarité de livraison qui crée une telle déconnexion. Tous les trois sont des performances frénétiques et infiniment agréables à part entière, mais réunis, ils sont extrêmement distrayants.
Jones joue Darlee à la fois enfant puis jeune adulte. Alors qu’elle observe son père, elle aspire à comprendre les dommages émotionnels qui lui sont infligés alors qu’il regarde les atrocités de la guerre à la télévision et qu’il essaie désespérément d’obtenir des médicaments et de l’aide pour son frère et sa famille à Bagdad. Il y a, bien sûr, autant de dommages émotionnels infligés à Darlee que son père devient de plus en plus distrait et absent de son présent. Les blessures du conflit se font également sentir loin de la ligne de front.
Philip Arditti est convaincant en tant que papa et parvient à résumer la fierté de sa patrie et l’horreur de la façon dont elle est déchirée. Arditti exprime son mépris respectueux pour les modes de vie anglais alors qu’il arrive pour la première fois dans les années 80 à Londres en tant qu’étudiant « le temps est mauvais, la nourriture est pire », mais le fait avec chaleur. Il y a une naïveté amicale – alors même qu’il rencontre une attaque raciste dans un bar, il ne voit initialement que la main tendue de l’amitié.
Bien que papa retienne ses terribles expériences à l’intérieur, Darlee absorbe le traumatisme tacite à chaque tournant. Il est déchirant d’entendre la fillette de huit ans répondre à la description affectueuse de son père de l’Irak avec un commentaire selon lequel « le ciel est vert avec des feux d’artifice qui éclatent la nuit » – sa seule vue de son Irak bien-aimé est la séquence de guerre sur la télévision et ces campagnes distinctes de bombardements nocturnes.
Jones travaille dur pour dépeindre un enfant qui peut voir la peur dans les yeux de son père. Un monologue final prononcé avec force se débarrasse de toutes les cloches et de tous les sifflets et parle directement de l’Occident en tant qu’agresseur, de ses sanctions causant autant de ravages que les bombes et du signal de vertu des masses bien intentionnées. C’est un truc puissant et pour la première fois, vous vous penchez vraiment en avant et vous écoutez.
Il y a de véritables moments poignants et déchirants – malheureusement, il y a tellement d’absurdité qui l’entoure cependant qu’il est très difficile de s’y accrocher.
…
…