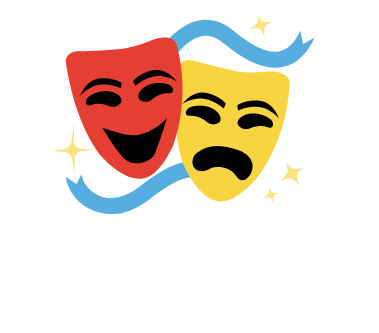Au milieu des ajournements de Covid, de la discorde de l’entreprise, d’une seule nomination d’Olivier et d’un compositeur-producteur assiégé qui non seulement s’est porté volontaire pour se faire arrêter si c’était ce qu’il fallait pour monter son émission sur scène, mais a ensuite qualifié l’ouverture du tout comme une « erreur coûteuse, » la presse négative entourant la courte série de l’année dernière dans le West End d’Andrew Lloyd Webber, Emerald Fennell et David Zippel’s Cendrillon l’emportait sur le bien. C’est peut-être pour ça qu’ils l’ont renommé Mauvaise Cendrillon pour son arc de Broadway à l’Imperial Theatre. S’ils pouvaient devancer la blague, ils pourraient peut-être faire en sorte que le public voie le spectacle pour ce qu’il est: un semi-gâchis effronté et excité, mais pas la perte totale que beaucoup d’entre nous attendaient.
Mauvaise Cendrillon a été conçu et écrit à l’origine par Jeune femme prometteuse L’actrice oscarisée Emerald Fennell, dont le livre a été adapté pour New York par Notre cher baron de la drogue mort le dramaturge Alexis Scheer. Une version révisionniste de la fable séculaire, elle se déroule dans le royaume français adjacent de Belleville, où tout le monde est chaud, et tous ceux qui ne le sont pas sont des parias. « Nos citoyens sont des œuvres d’art / tout le monde est un dieu ciselé avec un corps déchiré et rock », allez les paroles parfois intelligentes, parfois maladroites de Zippel dans le numéro d’ouverture, intitulé à juste titre « Buns ‘N Roses ». Tara Rubin s’est surpassée dans le département casting : les femmes sont sexy, et les gars, pour la plupart torse nu, sont branlés. Il y en a pour tous les goûts ici à Belleville.
Entrez notre « mauvaise » Cendrillon (Linedy Genao), attachée à un arbre en guise de punition pour avoir défiguré une statue du prince charmant, présumé mort. Elle n’est pas jolie selon les normes de Belleville, et son attitude pourrait nécessiter un peu de travail (bien qu’il soit indéniable que l’attrayant et affable Genao ne correspond jamais à aucune des descriptions des citadins). Le seul complètement épris d’elle est Sebastian (Jordan Dobson), le frère cadet du prince, qui se fait soutirer par leur mère, la reine (Grace McLean), pour épouser quelqu’un qui peut perpétuer la lignée royale. Que se passera-t-il une fois que la méchante belle-mère de Cendrillon (Carolee Carmello) et les demi-sœurs insipides Adele et Marie (Sami Gayle et Morgan Higgins) le découvriront, je me demande?
Non, Mauvaise Cendrillon ne gagne pas un Tony pour la retenue. Pour le meilleur ou pour le pire, et à une charmante exception près (qui a provoqué la plus grande réaction de la soirée), ce spectacle va exactement là où vous pensez qu’il va aller. Bravo, cependant, à Fennell (et Scheer) pour avoir au moins essayé de créer une allégorie anarchique de la dangereuse obsession de la beauté de notre culture, même si pas une seule ligne de dialogue ne passerait le test de Bechdel. Et à leur crédit, ils ont conçu le véhicule parfait pour les voleurs de scène comiques vétérans Carmello et McLean. Je ne suis pas sûr qu’il y ait une seule pièce sans leurs marques de dents, ce qui expliquerait probablement aussi pourquoi les conceptions fantaisistes de Gabriela Tylesova sont si bancales.
Lloyd Webber ne s’est pas rendu service en empruntant la principale ligne musicale de la série à une mélodie de Rodgers et Hammerstein de 66 ans. Il y a de belles chansons dans sa partition et celle de Zippel, notamment la ballade « Only You, Lonely You », que Dobson interprète avec la quantité parfaite de désir et de sincérité aux yeux de biche. Mais tout ce dont nous nous souvenons, c’est le numéro du titre dans sa forme originale, « dans mon propre petit coin / dans ma propre petite chaise / je peux être ce que je veux être ». Si les danses créées par JoAnn M Hunter étaient un peu plus variées, elles auraient pu aider la partition à éclater un peu plus.
Genao livre un doux rien d’une performance qui ne rayonne malheureusement ni mauvaise ni différente. De même, ni elle ni Dobson ne peuvent vraiment commander une si grande scène, et leurs deux voix semblaient un peu en lambeaux pendant la matinée des critiques la veille de l’ouverture. Mais ils sont tous les deux tellement gagnants qu’il est difficile de ne pas les encourager : la pureté de leurs performances les place finalement au-dessus de la ligne d’arrivée, bien qu’à peine.
Les principaux problèmes ici résident dans le réalisateur Laurence Connor, un habitué de Lloyd Webber surtout connu pour ses reprises épurées de mégamusicaux des années 1980 comme Fantôme, Les Miset Mlle Saïgon. Bien sûr, il met le spectacle sur scène et a demandé à un groupe de designers de lui donner du panache. Ce que Bruno Poet fait pour créer des vitraux à partir de lumière et d’ombre est tout simplement extraordinaire, et le paysage sonore cristallin de Gareth Owen nous permet d’entendre à la fois les paroles et l’orchestre à l’unisson, une nouveauté à l’ère du plus fort c’est mieux.
Mais un metteur en scène est également responsable du rythme, et au milieu du défilé de beefcakes en harnais S&M (les costumes de Tylesova vont de l’extravagant à l’étriqué), ballade après ballade nous sort de la frivolité. Il y a un coup de fouet dans le ton, du sarcastique au sincère, que la production peut tout simplement gérer. Et à cause de cela, l’horloge pourrait sonner minuit à Broadway aussi rapidement qu’elle l’a fait de l’autre côté de l’étang.
…