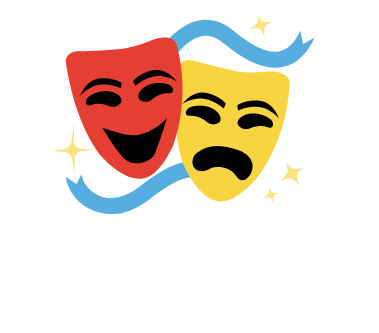Je me souviens très bien d’être sorti de la production originale épique de cette sombre comédie musicale au Shaftesbury Theatre en 2013 et d’avoir pensé qu’il pourrait y avoir un très bon spectacle enfermé quelque part dans la grandeur exagérée de la mise en scène de Tamara Harvey. Cette nouvelle version, réalisée par Brett Smock, qui a également dirigé la première américaine de 2016, réduit tout sauf le volume (plus à ce sujet dans un instant) mais ne constitue toujours pas un excellent argument pour un renouveau. Il offre une nuit passionnante et histrionique au théâtre, mais ne parvient que par intermittence à suggérer pourquoi Tim Rice (paroles), Stuart Brayson (musique), Bill Oakes et Donald Rice (livre) pensaient que cette histoire ferait une comédie musicale décente.
Le problème peut être les personnages. Le roman original de James Jones, et par la suite le scénario d’Oakes et Rice pour la comédie musicale, tire peu de coups de poing dans sa description des frustrations, sexuelles et autres, d’une compagnie de soldats américains s’entraînant, se battant et essayant généralement de ne pas perdre la tête dans la préparation de l’attaque japonaise sur Pearl Harbor qui forcerait l’Amérique à entrer dans la Seconde Guerre mondiale. La brutalité, le sexisme et le racisme abondent, et l’idée d’être présenté comme « queer » semble être la menace ultime. Au milieu de tout cela, la femme du commandant a une liaison avec son premier assistant, et un jeune fantassin qui est aussi un boxeur talentueux arrive, déterminé à ne plus jamais remonter sur le ring après avoir aveuglé un ancien adversaire.
Ce sont des choses sérieuses et adultes, mais contrairement à un roman, nous n’en apprenons pas assez sur les histoires de fond et les motivations pour vraiment investir dans les gens sur scène. Le script est professionnel mais pas particulièrement éclairant, certains acteurs sont un peu en bois, et lorsque les principaux s’expriment en chanson, le niveau de décibels est si élevé qu’il est difficile de déchiffrer ce qu’ils chantent réellement.
En conséquence, ils restent des chiffres boursiers éloignés et indistincts, malgré la distribution acharnée. Il y a le Capitaine froidement ambitieux (un Alan Turkington lancinant), sa femme pleine de ressentiment mais sensuelle (Carley Stenson, superbe), son amant rigidement dévoué (Adam Rhys-Charles), un soldat effronté à la double vie gay (Jonny Amies), un couple d’intimidateurs de l’entreprise, une prostituée pragmatique qui obtient le meilleur numéro (l’impressionnante nouvelle venue Desmonda Cathabel arrête presque le deuxième acte avec la ballade magnifiquement triste « Run Away Joe ») et sa madame amorale et qui parle dur (Eve Polycarpou mâchant le décor avec de vrais aplomb). Jonathon Bentley donne au Prewitt hanté et décent une altérité crédible et tourmentée, et une ceinture stratosphérique d’une voix chantante. Ce sont tous des « types » reconnaissables, présentés principalement avec conviction et compétence, mais rarement sympathiques ou même assez intéressants pour se connecter.
Stuart Brayson peut certainement créer une mélodie entraînante et la partition fonctionne mieux lorsque la musique devient bluesy ou anthémique, bien qu’elle rappelle davantage les opéras pop gargantuesques des années 1980 et 1990 qu’évocatrice des années 1940 lorsque le spectacle se déroule réellement. Les orchestrations bruyantes de Nick Barstow jettent tout contre le mur, du ukulélé à la guitare slide en passant par les cuivres et l’harmonica, mais donnent parfois à la musique un son presque indécemment joyeux par rapport aux histoires sinistres racontées. Tout le chant est tout à fait glorieux mais amplifié à un point tel que certains des grands numéros de chorale sont proches de causer un inconfort physique réel au lieu de l’euphorie qu’ils visent vraisemblablement.
L’ensemble encadré de palmiers de Stewart J Charlesworth place le public à chaque extrémité, ce qui donne des images de scène saisissantes lorsque toute la compagnie est présente (les dix minutes d’ouverture et de clôture sont authentiquement passionnantes), mais est incompatible avec les exigences de « parc et écorce » d’une grande partie de le score. Les chanteurs sont constamment obligés de se promener dans des moments de forte émotion afin que les deux côtés de la maison aient au moins un peu de temps face à face : égalitaire peut-être, mais c’est distrayant et prive plusieurs ballades de leur pouvoir. L’éclairage très atmosphérique d’Adam King et la chorégraphie macho de Cressida Carré fonctionnent bien dans un espace qui semble excitant mais qui finit par nécessiter une quantité fastidieuse de répétitions dans la mise en scène parfois maladroite de Smock.
Lorsque l’attaque de Pearl Harbor survient réellement, elle est mise en scène avec un éclairage aveuglant, des effets sonores terrifiants et beaucoup d’angoisse au ralenti, tandis que, simultanément, les femmes de la distribution livrent d’en haut, et avec une véritable passion, le mélancolique, mémorable hymne « Les Garçons de ’41 ». C’est un moment vraiment puissant et bouleversant dans une soirée qui pourrait en utiliser quelques-uns de plus. Pacifique Sud ce n’est pas le cas, mais cela ne banalise pas non plus une période troublante de l’histoire du monde.
je ne suis pas convaincu D’ici à l’éternité avait vraiment besoin d’être relancé, mais les publics qui manquent Saïgon et envie d’une pause de Les Mis mais qui veulent toujours être bombardés, pourraient bien passer un moment merveilleux.
…
…