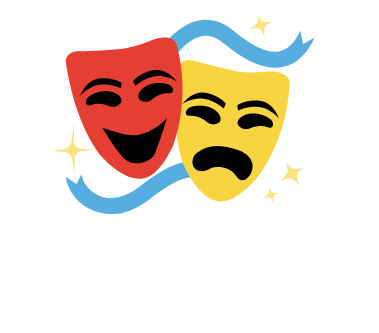Il n’y a pas de prologue « muse du feu » dans cette nouvelle audacieusement politique Henri V, une coproduction avec Headlong, Leeds Playhouse et le Royal and Derngate. Au lieu de cela, nous sommes plongés dans l’obscurité pour entendre la toux d’Henri IV dans son agonie à la fin de la pièce précédente, avertissant son fils de ne pas toucher à la couronne (« Tu cherches la grandeur qui te submergera »). Ce n’est qu’un des nombreux changements accrocheurs dans la production de Holly Race Roughan, dont le plus important est gardé pour la fin.
Les fantômes prolifèrent dans l’action, alors que Henry d’Oliver Johnstone oscille sauvagement entre le roi guerrier et l’âme torturée. Dans un moment particulièrement frappant, il étrangle le traître Lord Scroop (Darmesh Patel) à mort à mains nues, puis le voit sous les traits d’une succession de messagers (tous joués par Patel). Son tourment intérieur est résumé par sa prononciation du discours « Une fois de plus sur la brèche », qui commence par un Hamlet-esque soliloque et crescendos dans un match de lutte bruyant.
La méta-théâtralité perdue avec l’excision du prologue est en quelque sorte restaurée par la lecture des numéros de scène et des noms de personnages (« Enter Pistol », etc.). Et l’ambiance brechtienne est encore renforcée par les acteurs – costumés en hipsters, tous baskets et bonnets – assis sur des bancs de part et d’autre de la scène pour les scènes d’ouverture (ça rappelle l’excellent Métamorphoses ici l’année dernière, que Roughan a co-réalisé).
Les résonances contemporaines sont partout, du chant fan de football de « God Save the King » à l’accent mis par la production sur les crimes de guerre commis par une force d’invasion. La séduction bâclée d’Henry d’une très jeune princesse Katherine (Joséphine Callies) prend quant à elle un côté beaucoup plus sombre, et la fin susmentionnée fait une comparaison très directe entre notre attitude envers les étrangers d’hier et d’aujourd’hui.
La conception de Moi Tran voit une toile de fond verte bucolique retirée pour révéler un mur froidement industriel alors que la flotte navigue vers la France, tandis que la tension de l’invasion est bien montée en flèche par la musique de Max Pappenheim, jouée par un groupe de quatre personnes qui comprend un Nyckelharpa suédois. Les bougies du Sam Wanamaker (c’est le début de la pièce dans l’espace) sont subtilement complétées par une lumière artificielle pénétrant à travers une trappe de toit. C’est une production qui mélange harmonieusement classique et contemporain.
Le bel ensemble est particulièrement impressionnant avec les passages plus physiques de la production. Ils montent et descendent des échelles sur le mur du fond et se frappent joyeusement sept cloches. Une grande partie de cela est à la demande du psychotique et hargneux Henry de Johnstone, qui les pousse et semble aimer la violence (vous verrez rarement une balle de tennis utilisée de manière aussi menaçante). Parmi les autres vedettes, citons Eleanor Henderson dans une gamme de personnages français, dont le prince Louis, Jon Furlong dans le pitoyable Bardolph et Helena Lymbery dans le personnage obsédant d’Henri IV.
Tout compte fait, c’est à peu près aussi éloigné que possible du chauvinisme de l’interprétation d’Olivier. Ce qui correspond à une époque où la vision de la Grande-Bretagne sur elle-même est actuellement, pour le moins, dans la balance. Bien qu’il ait parfois l’impression que le texte (la dramaturgie est de Cordelia Lynn) a été trop déformé par rapport à la vision, sa puissance ne fait aucun doute. Jamais auparavant je n’ai trouvé la pièce aussi déconcertante.
…
…