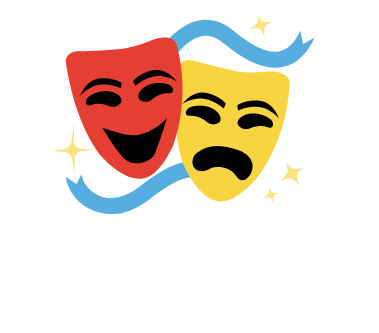Je dirai ceci pour la nouvelle pièce de Terry Johnson, qui rouvre la chocolaterie après une fermeture prolongée : cela vous donnera matière à raconter par la suite. Johnson, qui revient à l’adresse où il a connu des succès précédents, notamment sa production primée à plusieurs reprises de La Cage Aux Folles, plonge tête première dans une série de questions brûlantes, notamment les droits des trans. Et il le fait à travers le médium accrocheur d’une comédie sexuelle.
Maintenant, tout d’abord. Il y a des doublures pointues, une pincée de performances impressionnantes et un magnifique ensemble de cuisine qui ressemble à une double page de Living Etc. Cependant. Il y a aussi des stéréotypes franchement époustouflants, une vanité centrale terriblement mal jugée et une prolifération de thèmes délicats traités avec toute la sensibilité – pour citer Malcolm Tucker – d’un clown dans un champ de mines (mais alors, c’est un peu le but).
Alex (Jason Merrells), la cinquantaine, et sa jeune petite amie Hetty (Molly Osborne) accueillent des invités dans leur maison de ville d’Islington pour une soirée arrosée d’échanges de partenaires hédonistes. Ou du moins, c’est le plan. Rejoindre l’action sont Gilly (Lisa Dwan), qui a une histoire avec Alex, un fait pas perdu sur le mari jaloux Jake (John Hopkins). Ensuite, il y a l’alpha américain Jeff (Timothy Hutton – qui fait ses débuts sur scène à Londres) et sa femme russe Magdalena (Amanda Ryan) à l’accent prononcé mais au langage simple, et le drogué chic Tim (Will Barton) avec sa partenaire de droite Camilla (Kelly Price) .
Le premier acte se déroule de manière assez piétonne alors que les couples apprennent maladroitement à se connaître et échangent des opinions sur des questions allant de la politique aux mérites de la gamme de vins de Graham Norton. Le sexe se déroule en grande partie dans les coulisses du salon, avec des gémissements et des gémissements qui filtrent dans la cuisine, où ceux qui ne sont pas impliqués spéculent sur l’état de leurs relations et sur la façon dont ils ont découvert le style de vie de l’amour libre.
Le ton prend un virage décisif lorsque la femme transgenre Lucy (Pooya Mohseni) arrive. Elle provoque chez les invités des réactions aussi grossières que prévisibles, faisant du second acte une sorte de fil twitter dramatisé. Il y a des moments amusants, comme lorsque Tim laisse échapper « alors que pensez-vous des trucs de JK Rowling? » – une question que redoute toute réunion sociale. Mais il y a aussi trop d’occasions où les personnages expriment des opinions qui se sentent horriblement artificielles. « L’identité de soi constitue une menace pour la famille nucléaire », postule Jeff dans l’une des nombreuses lignes qui ressemble au titre d’un blog.
À certains égards, il y a une audace louable dans la façon dont Johnson entreprend d’explorer ce territoire délicat. La pièce n’a certainement pas peur de diffuser des points de vue assez désagréables et est tout sauf ennuyeuse. Tout est mis en scène et interprété avec panache – c’est un ensemble stellaire – et somptueusement conçu par Tim Shorthall, évoquant parfaitement le milieu de l’élite métropolitaine. Il y a aussi quelques choix musicaux agréables du concepteur sonore John Leonard (« Come Together » et « Both Sides Now », par exemple).
Mais l’impression générale est que Johnson a essayé d’entasser beaucoup trop dans une seule pièce, principalement dans le but de remuer un nid de frelons wokey, et le message ne correspond tout simplement pas au véhicule. Mohseni, qui est elle-même une militante transgenre, donne une performance convaincante en tant que Lucy. Mais la pièce l’entoure de chiffres exprimant des arguments qui, heureusement, ont en réalité tendance à être plus nuancés. La tournure finale étrange le résume, se sentant à la fois commodément artificielle et tonalement maladroite.
…
…