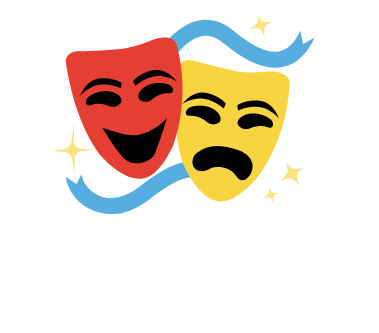Dans les James Plays, mis en scène pour la première fois en 2014, Rona Munro a écrit l’une des grandes trilogies de pièces d’histoire de cet âge ou de tout autre. Immenses et fascinantes à regarder, elles ont retracé l’histoire de l’Écosse, faisant revivre le passé et parlant au présent avec une puissance remarquable. Elle continue de suivre les monarques appelés James avec trois autres pièces imaginées. En attendant, vient Marieun ajout autonome décevant à cette entreprise ambitieuse.
Il prend l’histoire de Mary Queen of Scots et la présente de côté, révélant Mary à travers les yeux de trois membres de sa cour – le diplomate James Melville, son partisan depuis l’enfance, une incendiaire protestante appelée Agnes, qui craint que la reine ne trahir la nouvelle religion protestante et l’homme en devenir Thompson, qui se range du côté des seigneurs écossais qui veulent que la reine disparaisse.
À travers deux longues scènes de témoignage – l’une dirigée par Melville et l’autre avec Thompson en charge – la pièce examine les événements cruciaux et compliqués de 1567 après que le mari de Mary, Darnley, a été assassiné et qu’elle a épousé l’homme qui l’aurait tué, le comte de Bothwell. Les résultats ont été désastreux : cela a conduit à la rébellion, à l’abdication et finalement à la mort de Mary. L’affirmation de Munro est que Mary a été violée et forcée de se marier contre sa volonté.
C’est une vision intéressante de la vie de la reine, plus traditionnellement présentée comme une héroïne romantique qui suivait son cœur et non sa tête et choisissait toujours le mauvais homme. Ici, elle apparaît comme une victime de son genre, une femme dans un monde d’hommes de politique intrigante et de clivages religieux. Le problème, c’est que nous voyons à peine Mary – elle ne fait que voler sur la scène de temps en temps – et la pièce est, malgré toutes ses références féministes, vraiment une étude d’un homme, le Melville en conflit.
Douglas Hensall, fraîchement sorti de son triomphe en Shetland, le joue avec un contrôle mordant. C’est un homme qui est si confiant qu’il est en charge des événements que son propre côté aveugle le prend par surprise; il en va de même pour la révélation qu’il pourrait se comporter comme il le fait, abandonnant sa reine en cas de besoin.
Rona Morison, dans le rôle d’Agnès, lui correspond, étape par étape. Il est difficile de croire au personnage – une servante dans une cour du XVIe siècle aurait-elle été aussi audacieuse en défendant ses croyances religieuses et contre sa maîtresse ? Et elle n’a pas grand-chose à dire; quand elle se plaint de ne pas avoir parlé pendant dix minutes pendant que les hommes se disputent, c’est vrai.
Mais Morison rend Agnès convaincante en elle-même, sa certitude à bras droits du tort de Mary soudainement ébranlée par sa prise de conscience de la vulnérabilité mutuelle. Brian Vernel complète un impressionnant trio de performances en tant que Thompson, tour à tour sournois et nerveux, effrayé et effrayant.
L’écriture de Munro est toujours magnifiquement posée et équilibrée. Pourtant, ici, en quelque sorte, il se sent dépourvu de passion. La pièce n’est que trois personnes qui parlent assez lentement dans une pièce. Dans la conception habile d’Ashley Martin Davis, la pièce est ravissante, avec ses murs lambrissés et l’éclairage magnifiquement modulé de Matt Haskin projetant les joueurs dans les riches teintes d’une peinture d’époque. Mais la mise en scène de Roxana Silbert est calme jusqu’à la somnolence ; il n’y a rien pour ralentir le rythme jusqu’à une intervention irréfléchie juste à la fin.
Au lieu d’être saisissants, les conflits de la pièce – entre une nation protestante et une reine catholique, entre des hommes qui s’accrochent au pouvoir et des femmes qui s’accrochent à leur vie, entre la vérité et le mensonge – tournent en rond sans jamais s’envoler. C’est une entreprise curieusement sans air.
…