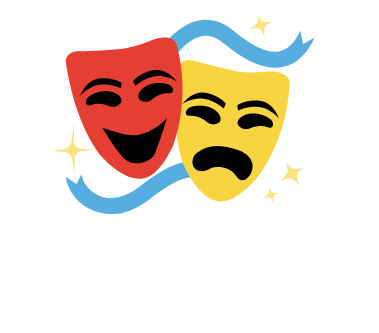Dans un moment fugace pendant le premier acte de cette merveilleuse comédie dramatique galloise alors que je n’étais pas complètement absorbé, il m’est venu à l’esprit que Roméo et Julie était vraiment une variation sur l’histoire d’amour classique de Shakespeare de nom seulement. Certes, ces adolescents amoureux des temps modernes de Splott sont maudits dans la mesure où leurs perspectives de relation à long terme ne semblent pas bonnes (il est un père célibataire, elle est super intelligente et part lire la physique à Cambridge) mais leurs familles ne sont pas en conflit, personne ne meurt et il n’y a ni frère ni infirmière en vue.
Si la seconde moitié présente quelques développements de l’intrigue qui la relient plus étroitement à l’original de Shakespeare, la merveilleuse pièce de Gary Owen est à ce moment-là devenue tellement sa propre bête spéciale et le public est devenu tellement investi dans ses protagonistes envoûtants, qu’il n’est plus plus compte vraiment. Les poignées de mise en scène granuleuses et explosives de Rachel O’Riordan dès le début, le casting de cinq ricochets à travers le décor de rechange et crasseux de Hayley Grindle alors que la danse bat le tonnerre et les néons blancs clignotent au-dessus, avant de s’arrêter dans une scène sombre et drôle avec un jeune de 18 ans Roméo nettoie sa petite fille fraîchement souillée sous les yeux de sa mère jugeante et alcoolique. Le ton et la sensation sont austères, urbains, impitoyables… une toile de fond étonnamment abrasive pour l’histoire d’amour tendre mais difficile qui suit.
Lorsque ce Roméo et Julie se rencontrent, elle le prend pour un sans-abri, puisqu’il dort à une table de café en plein jour, et il est époustouflé par son affirmation qu’elle va s’enfuir à l’université. Sa jeune vie regorge de possibilités alors que tant de portes ont déjà été claquées sur la sienne. Ce qui est beau cependant, c’est que malgré toute la méfiance et les plaisanteries, elle ne lui parle jamais de manière dépréciée, prenant le temps d’expliquer son intérêt pour la physique quand il le demande, et nous nous rendons compte que sa description de la théorie de la relativité par rapport à la théorie quantique (« certaines choses minuscules et massives à la fois ») pourraient également s’appliquer à cette rencontre entre deux âmes brillantes et uniques.
Malgré les différences évidentes entre eux, il n’est pas difficile de voir ce que Roméo de Callum Scott Howells et Julie de Rosie Sheehy voient l’un dans l’autre. Malgré un extérieur bourru, nerveux et gauche, ce Roméo est tout à fait charmant avec un relent indubitable de vulnérabilité. Plus que ça, quand il décrit comment il a pris en charge sa petite fille alors que la mère biologique n’était pas intéressée, ou quand il part à travers la ville pour sauver sa propre maman d’une énième escapade ivre, on se rend compte, tout comme Julie, qu’il s’agit d’un homme naturellement bon, prêt à sacrifier son propre bonheur pour assurer celui des autres. Dans une performance obsédante mais tout à fait véridique, Howells suggère brillamment un personnage pour qui la flamme de l’espoir s’estompe, mais qui ne peut tout à fait se permettre de la laisser s’éteindre complètement.
La Julie de Sheehy est éblouissante : chaleureuse, pleine d’esprit, féroce, extrêmement confiante mais jamais odieuse. La voir réaliser la profondeur des sentiments qu’elle ressent à la fois pour Roméo et sa petite fille est profondément touchante. La chimie entre les protagonistes est combustible et il est fascinant de noter comment, malgré toute leur force et leur passion, ils semblent souvent se transformer en enfants lorsqu’ils sont dans des scènes avec des personnages « adultes », un autre détail dans une production riche et vivante avec eux.
Dans un autre joyau d’une performance, Catrin Aaron investit la mère fragile de Roméo avec un esprit caustique. Paul Brennen est profondément émouvant dans le rôle du père de Julie, adorant mais devenant de plus en plus conscient qu’il a élevé un enfant qu’il comprend à peine. Il a une scène de confrontation tardive avec Roméo qui est à couper le souffle dans sa combinaison de vérité laide et d’émotion refoulée. Anita Reynolds complète un casting sans faille en tant que partenaire, une soignante professionnelle si habituée à tempérer sa gentillesse avec pragmatisme qu’elle ne réussit presque pas pour sa propre fille adoptive. Elle reçoit un discours brûlant sur le gouffre entre le personnel des professions de soins sur le terrain et le coût que le travail prend sur leur vie, et les patrons qui gagnent de l’argent pour qui «prendre soin» est une marchandise; c’est un moment époustouflant, immobile mais furieux, et Reynolds le livre avec puissance et économie.
L’écriture d’Owen est magnifique : tendue, concise mais théâtrale, et souvent joyeusement grossière. Il trouve la poésie dans le discours ordinaire (à un moment donné, Roméo dit de bébé Neve qu' »elle me brise le cœur tous les jours, mais chaque jour il repousse ») et aussi la comédie à rire aux éclats dans ses absurdités. Il y a une conscience sociale aiguë à l’œuvre ici, et chaque personnage est si richement texturé et présenté sans commentaire ni condescendance. La pièce se déplace à un rythme infernal mais a des moments d’immobilité irrésistibles, comme de petites oasis de confort dans le drame bouillonnant de ces vies qui implosent.
Avec quoi Debout au bord du ciel, une collaboration avec Sheffield Theatres, arrachant tous les soirs le public en larmes de leurs sièges à l’étage de l’Olivier, et maintenant cette coproduction enrichissante avec Sherman Theatre Cardiff installée dans le plus petit Dorfman, la relation avec le National et certains de ses cousins régionaux n’a jamais semblé plus essentiel. Oubliez ces enfants sur un balcon à Vérone, Roméo et Julie est un incontournable. Gwaedlyd wych, comme on dit au Pays de Galles.
…