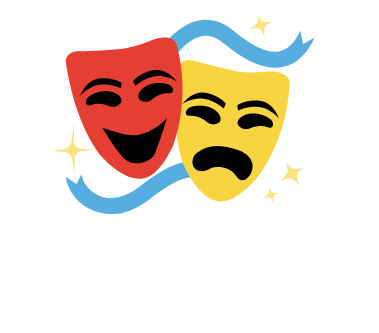Quiconque a vu l’adaptation cinématographique de Tom Ford de la nouvelle de Christopher Isherwood Un homme celibataire est susceptible de faire une double prise lorsque Theo Fraser Steele est adapté, démarré et à lunettes en tant que George dans cette version scénique, tant il ressemble à Colin Firth dans le même rôle dans le film. Cette ressemblance se poursuit lorsqu’il commence à parler, capturant exactement le même anglais tordu et ironique qui contraste de manière si révélatrice avec le ton traînant californien de la plupart des autres personnages.
La pièce de théâtre de Simon Reade est susceptible de plaire à tous ceux qui ont aimé le livre original. La langue d’Isherwood est élégante, exquise et rarement prosaïque. Le problème avec une adaptation aussi fidèle est que cela ressemble rarement à de vraies personnes qui parlent. Ce n’est pas la faute de la belle distribution, qui essaie de l’investir avec autant de vie et d’authenticité que possible, mais ils ont constamment l’air de régurgiter des morceaux d’un livre, ce qui est à peu près ce qu’ils font.
L’absence de véritable conflit dramatique n’aide pas, pas plus que la nature épisodique du scénario de Reade, dont la première moitié a des personnages et des décors qui se succèdent rapidement mais avec peu d’impact. Courant à moins de deux heures, il pourrait bénéficier de perdre l’intervalle, ce qui ressemble à une intrusion et brise le dynamisme du jeu. Le scénario, tel qu’il est, est une sorte de rêve fiévreux alors que George, d’âge moyen, rejoue ses amitiés et son amour perdu sous un soleil de plomb au moment où il est sur le point de se débarrasser de cette spirale mortelle. C’est intrigant et bien géré sous la direction de la flotte de Philip Wilson, mais ne prend jamais de feu dramatique.
Malgré la solide performance de Theo Fraser Steele, George est une figure trop éloignée et boutonnée pour se connecter véritablement. C’est un personnage qui profite vraiment des gros plans et des coupes sautées de l’écran : sur scène, il est simplement « là », une présence pleine d’esprit et urbaine mais trop inconnaissable pour qu’on s’y investisse vraiment. Nous assistons à la douleur de George à la perte de un jeune amant mais on ne le sent jamais. Cependant, les acteurs de l’ensemble – Freddie Gaminara, Miles Molan et Phoebe Pryce – font un travail formidable dans un assortiment de rôles. Olivia Darnley est un magnifique faisceau de lumière en tant qu’amie la plus proche de George, une Britannique nécessiteuse et amoureuse à la dérive dans la splendeur californienne, même si elle lit comme un peu jeune pour avoir un fils de dix-neuf ans.
La conception de l’éclairage de Peter Harrison fait de petits miracles en transformant l’ambiance et le temps sur un plateau de Caitlin Abbot, qui a l’air austère mais capture l’aspect concret impitoyable des descriptions originales d’Isherwood sur le Los Angeles des années 1960 dans le livre. La mise en scène de Wilson évoque de manière convaincante une période de temps très spécifique, la direction du mouvement de Natasha Harrison ajoutant un aspect convaincant et onirique à certains moments.
Ce n’est jamais moins que regardable, et la langue est quelque chose à savourer même si elle défie la théâtralisation, elle a juste besoin de plus de feu dans son ventre et d’une image plus claire du protagoniste central. Le jeu d’acteur est excellent cependant, et les amateurs d’Isherwood l’aimeront probablement.
…
…