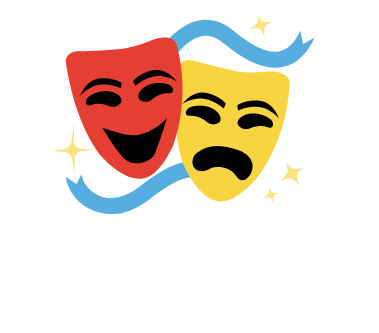Quand Le tourbillon paru en 1924, après avoir survécu à la volonté de censure de Lord Chamberlain de l’interdire, il a fait la réputation de son scénariste, réalisateur et vedette Noël Coward.
À la fois comédie de salon et « jérémiade contre les stupéfiants », selon les mots de Kenneth Tynan, elle conserve son pouvoir près d’un siècle plus tard grâce à l’intensité de sa description de la relation mère-fils de Florence et Nicky Lancaster.
Florence veut désespérément préserver sa jeunesse, se jetant au monde avec un jeune amant à son bras. Nicky – le rôle que Coward a joué à l’origine – veut désespérément son amour et son acceptation. Lorsque ses fiançailles pataugent au cours de l’action, cela précipite une crise d’identité qui rappelle la relation trouble d’Hamlet avec sa propre mère.
L’argument de vente de cette production du Festival de Chichester est que Florence et Nicky sont joués par la vraie mère et son fils Lia Williams et Joshua James, qui abordent cette confrontation finale avec une émotion terrifiante. Elle est tout en agitant les bras et la terreur, une figure monstrueusement vaniteuse incapable de voir au-delà de son propre besoin narcissique alors qu’elle évite la réalité, « voulant tout le temps que la vie soit telle qu’elle était au lieu de telle qu’elle est ».
Il est tout tremblant d’émotion, craignant sa dépendance ainsi que son sens d’une vie cachée – la pièce fait clairement allusion à son homosexualité, avec Coward repoussant les limites de la vérité aussi loin qu’il était possible de le faire à l’époque. C’est une conclusion captivante de la nuit, peut-être plus Strindberg que Coward, mais néanmoins dévastatrice.
La production expressionniste de Daniel Raggett se construit sans relâche jusqu’à ce point. À ce moment, le décor élaboré de Joanna Scotcher, qui évoque parfaitement la décoration oppressante de la vie privilégiée de Florence, a été dépouillé dans un cercle de lumière où la mère et le fils rôdent comme des animaux hurlant à la lune.
Le problème avec cette approche est que l’esprit de Coward se perd parfois dans la ruée vers le drame. Son mélange étrange et séduisant d’humour sophistiqué et d’émotion sincère est en quelque sorte déséquilibré. Les mots sont délibérément perdus dans le désir de la production de créer une incarnation physique du « vortex de bestialité » dans lequel Nicky se sent piégé.
Lorsque les mots sont aussi bons que « J’ai toujours su que le continent était fatal pour les jeunes », prononcés avec une précision mordante par le finement jugé Pauncefort de Richard Cant, la perte semble très aiguë. Le ton est trop implacablement sombre.
Il y a néanmoins beaucoup à admirer et à apprécier. Helen, qui parle franchement, de Priyanga Burford, qui voit si clairement la souffrance de Nicky et l’égocentrisme de Florence, est une présence charmante et calme; il en va de même pour Hugh Ross dans le rôle du mari négligé dont les apparitions mélancoliques sont trop brèves.
Surtout, le renouveau rappelle à quel point un écrivain audacieux et brillant était Coward, à quel point il comprenait profondément le cœur humain dans toute son illusion, alors même qu’il tenait ses personnages à la lumière de son intelligence incisive.
…