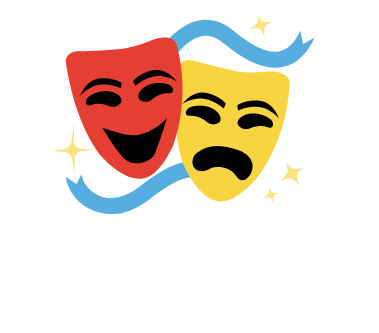Il y a une idée vraiment intrigante au cœur de cette pièce nominée au Pulitzer de Jordan Harrison, qui n’a rien perdu de sa pertinence depuis sa première mise en scène en 2014.
Le drame futuriste est centré sur Marjorie (Anne Reid), une femme aux prises avec une perte de mémoire en ressuscitant son défunt mari Walter sous forme d’IA (Richard Fleeshman). L’avatar incroyablement réaliste, appelé à juste titre Prime, peut régurgiter leurs histoires partagées et agir comme un moyen à la fois de préserver et de prolonger leur vie ensemble. Les souvenirs heureux – un chiot qu’ils ont récupéré à la fourrière, la nuit où il a fait sa demande en mariage – prennent le pas sur les souvenirs traumatisants.
L’action se poursuit ensuite pour montrer comment Marjorie elle-même devient Prime, cette fois pour réconforter sa fille en deuil Tess (Nancy Carroll). Tess aurait pu recréer sa mère en tant que femme plus jeune, mais choisit de parler à l’ancienne version. Cela en soi est révélateur, tout comme la façon dont Tess corrige le Prime lorsqu’elle est trop affectueuse. C’est profondément poignant, soulignant la façon dont les souvenirs agissent à la fois comme consolateurs et tourmenteurs.
La production élégante et de rechange de Dominic Dromgoole présente un ensemble impressionnant, complété par Tony Jayawardena en tant que mari dévoué de Tess, Jon. Ensemble, ils capturent le sentiment d’une famille cherchant désespérément des solutions numériques à sa souffrance très humaine. Reid donne une performance superbement discrète dans le rôle titre, et sa chimie avec Carroll – apparaissant héroïquement après une crise de laryngite virale – est particulièrement touchante.
Lorsque les acteurs sont en mode Prime, leur robotique est subtilement sous-estimée. Fleeshman, que l’on ne voit que sous forme de robot, pourrait initialement passer pour une vraie personne. Il y a un sentiment, renforcé par la façon dont les Primes sont assis dans un éclairage fantomatique hors scène, que la frontière entre l’homme et la machine s’estompe au point d’être invisible (comme le commente Tess, « chaque jour est de la science-fiction »).
L’ensemble d’appartements avec vue sur la mer de Jonathan Fensom est incroyablement futuriste, tout en lignes épurées et art de designer, accentué par l’éclairage chaleureux d’Emma Chapman. La luminosité de tout cela pourrait même laisser entendre qu’il s’agit d’une époque (la pièce se déroule dans la seconde moitié de ce siècle) déchirée par des températures en flèche. C’est un monde où la technologie s’intègre parfaitement à la vie domestique ; Les iPhones appartiennent définitivement au passé.
Il y a un nombre impressionnant de thèmes emballés dans le temps de fonctionnement de 75 minutes. Au centre d’entre eux se trouve la question de savoir si, si la technologie peut nous donner une sorte de vie éternelle pixélisée – une perspective qui ne semble pas si lointaine ces jours-ci – nous le voulons vraiment. C’est une idée provocante et pertinente, seulement déçue par un acte de clôture qui ressemble à un mauvais cas de saut de requin. Les meilleurs moments de la pièce surviennent lorsqu’elle se concentre sur certaines fragilités humaines trop familières, et celles-ci méritent une résolution plus puissante.
…
…