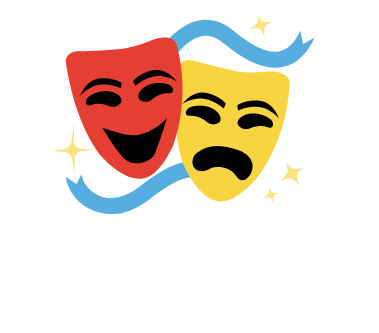Harold Pinter et les Ustinov partagent un point commun dans la mesure où chacun est le créateur de miniatures produisant un effet maximaliste. Le travail de Pinter, à première vue, semble être du menu fretin, plein de banlieues domestiques et de conversations qui se déroulent dans des cercles toujours plus nombreux, sans jamais être complètement résolus, mais qui contiennent d'énormes et douloureuses émotions humaines et des questions sur une société qui se sent en avance sur son temps. Pendant ce temps, l'Ustinov, ce petit studio d'un peu plus de 100 places niché sur le côté de la maison principale du Theatre Royal Bath, produit constamment des œuvres aux proportions épiques qui, en termes d'influence et d'ambition, dépassent largement ses humbles origines. Machine n'est que la dernière émission à connaître le succès après Bath.
Ces deux one-acters, L'amant et La collection, écrites à l'origine pour la télévision en 1962 et 61 respectivement, sont des œuvres qui suggèrent les atours des relations de banlieue ordinaires, une monotonie agrémentée d'une touche menaçante par un soupçon de liaison matrimoniale, sous forme de jeu ou de rumeur. Pinter, un homme qui a eu sa propre vie conjugale compliquée, semble être sensible aux fixations érotiques d’en ajouter un troisième. Les jeux de rôle de Richard et Sarah dans L'amantgardez l'amour vivant alors même que Richard demande si sa femme a montré à son amant « les roses trémières ».
L'utilisation du langage par Pinter, avec sa délicieuse équation de syllabes et de sons onomatopées, atterrit magnifiquement dans l'espace, mais c'est dans le frisson de savoir si le couple ne peut réellement exister que dans le bonheur avec ses propres maîtresses et amants qui donne un avantage à la pièce. Harry et Sarah ne jouent peut-être que les devoirs de l'après-midi, mais quand Harry commence à craquer, réalisant que c'est peut-être « l'amant » plutôt que le « mari » qu'elle préfère, la douleur de la vie conjugale est atténuée. L'année avant qu'Edward Albee ne tue un enfant lors d'un jeu de société à Qui a peur de Virginia Woolf ?, Pinter a ici sa propre forme de destruction.
L'œuvre la plus fascinante et la plus mystérieuse est La collection qui commence par un appel téléphonique à 4 heures du matin et se termine avec quatre âmes ne sachant pas comment procéder. Bill a-t-il couché avec la femme de James, Stella, dans un hôtel à Leeds, et ce faisant, a-t-il découvert un désir inhérent chez le mari cocu qui provoque des tensions chez le petit ami et bienfaiteur plus âgé de Bill, Harry ? L’idée centrale de la dynamique du pouvoir, et avec chaque phrase chargée de sous-textes qui clarifient et mystifient dans une égale mesure, est une œuvre qui ressemble typiquement à Pinter.
La réalisatrice Lindsay Posner, dans des décors à deux périodes adjacents de Peter McKintosh, avec des miroirs à l'arrière reflétant le public comme sa propre forme de voyeurs, est sensible à l'utilisation du langage et de l'atmosphère, même si elle manque légèrement de mise en scène dynamique.

Pour ceux comme moi, qui peuvent parfois avoir du mal à rester du côté du manque de certitudes de Pinter, la principale raison de le voir est la formidable double performance de David Morrisey qui amène Richard et Harry à une vie douloureuse. Morrisey a le don étrange d’apporter à la fois décence et menace aux rôles. Dans L'amant, il est tout sourire en tant que « chéri, je suis mon mari au foyer », tout en menace comme le bonhomme qui vient frapper dans l'après-midi. Dans La collection, il est tout en menuet et en posture vaine en tant qu'amant plus âgé qui semble détenir les cartes dans sa relation avec son jeune partenaire créateur de robes, mais ne peut pas contrôler le désir qu'il engendre chez les autres. Le fait de combiner ces deux parties ensemble donne l'impression que la soirée est plus dirigée par des stars que d'autres itérations de casting récemment vues dans les productions londoniennes, mais Morrisey gère ce double (ou s'agit-il de cinq rôles) et vaut à lui seul le prix du billet.
Il est habilement soutenu par Claudie Blakley dans le rôle des deux femmes ; tout en escarpins à talons hauts pour son amant dans le premier, tout en raisonnement impénétrable dans le second, alors qu'elle se prélasse sur le canapé, caressant un chat à l'air légèrement pétrifié, on a l'impression que même si Pinter a souvent fait de ses rôles féminins les forces motrices , ils ont rarement la chance d’être le protagoniste. Mathew Horne démontre que la luxure et la violence font bon ménage, caressant une lame comme s'il ne savait pas s'il devait la caresser ou l'empaler dans son rival amoureux potentiel. Pendant ce temps, Elliott Barnes-Worrell est tout au charme sensuel dans le rôle de Bill, tenant apparemment tout le monde sous l'emprise de son magnétisme.
Peut-être y a-t-il le sentiment dans ces courts métrages qu'on nous sert quelques entrées plutôt qu'un plat principal et que nous repartons donc légèrement sous-alimentés. Fidèlement réalisé, interprété efficacement, mais cela ressemble à un prélude à quelque chose à venir, dans ce cas, la reprise par Richard Jones de La fête d'anniversaire plus tard cet été.