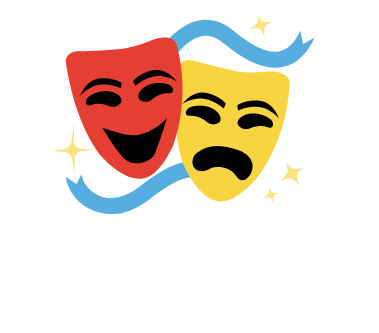Le diable lui-même nous accueille au début de la tonalité sauvage mais impressionnante de Lulu Raczka Femmes, méfiez-vous du diablequi a sa première mondiale à l’Almeida.
Laissant tomber quelques spoilers et nous avertissant que nous avons une longue pièce en réserve tout en tenant un journal récent, le personnage cornu et séduisant (joué par un Nathan Armarkwei-Laryea moustachu, qui se révèle être une présence parfaitement caméléon à travers les 135 minutes soirée) nous transporte dans l’Angleterre du 17ème siècle – une époque de conflits nationaux alors que le roi est renversé du trône et que la guerre civile éclate.
C’est un cadre juteux. Comme n’importe quel historien britannique de l’époque moderne le dirait avec lyrisme, les années 1600 voient une usurpation complète du corps politique – la tête est enlevée et ce qui reste est monstrueux, pataugeant dans l’agonie et les dissensions internes. À cet égard, Raczka a choisi la toile parfaite pour un conte de sorcellerie, de conflit de classe, de sensations fortes et d’intrigue.
Comme un mélange de Crimson Peak, le favori et même une petite dose de Centre-villele scénario suit la riche propriétaire Elizabeth (Lydia Leonard, à parts égales ruse et désespoir) qui recrute Agnes (Alison Oliver, qui a beaucoup plus à faire ici que dans le guindé). Conversations avec des amis série télévisée) pour persuader son frère Edward (un Leo Bill infiniment magnifique) de faire la paix avec sa nouvelle épouse Katherine (Ioanna Kimbook, parfaitement présentée) afin de sécuriser la lignée familiale et de garder intact le statut de riche de sa famille. Charnel, comique et décalé, à partir de là, les choses passent d’audacieuses à sanglantes alors que la guerre civile commence et que le nombre de morts augmente.
Les motivations individuelles échappent à tout contrôle au fur et à mesure que les choses progressent – exacerbées par le marché faustien d’Agnès, les coups de poignard dans le dos et les intrigues généralement anarchiques – mais le sens plus large de la tension parvient à s’installer dans la production relativement assurée de Rupert Goold. Créant l’illusion de profondeur et de salles de manoir caverneuses (les fans de l’œuvre de la Renaissance de Raphaël seront fiers), l’ensemble de Miriam Buether est convaincant (bien qu’il ait des échos du clip de « I Know Him So Well » de Échecs).
Bien que violents par endroits (apparemment, des scènes de crevaison oculaire ont été supprimées pendant la préparation parce qu’elles étaient trop sanglantes), les thèmes centraux du genre, du mariage, de l’accouchement et des bouleversements sociaux à une époque de troubles religieux purs et simples sont tous charnus et montrés à grand effet. La manière dont la sorcellerie et les cultures ouvrières sont appropriées par l’élite (Elizabeth voulant désespérément utiliser les « dons » d’Agnès pour s’assurer sa propre richesse) pour leurs propres besoins est également pertinente et fascinante.
C’est aussi drôle comme un péché – l’obsession constante de Bill pour le boeuf attire des vagues de rire, tandis que les tournures de phrase anachroniques du deuxième acte rendent l’expérience post-intervalle beaucoup plus lumineuse et plus percutante.
Bill et Leonard semblent fermement à l’aise avec les excentricités de l’écriture de Raczka, tandis que d’autres semblent paralysés par ses changements de ton les plus extrêmes. La caractérisation reste inégale (Certains veulent-ils sauver la maison ? Veulent-ils tout brûler ?) et certaines scènes semblent trop courtes tandis que d’autres dépassent leur accueil. Comme un panneau de Bosch Jardin des délices terrestresla manie infernale est passionnante, si elle manque de cohésion.
…