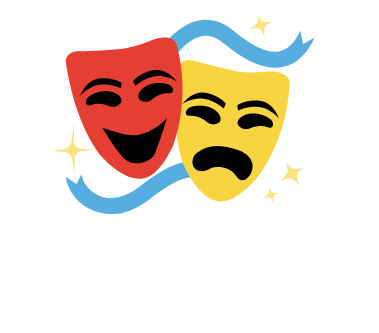La grande violoncelliste britannique, Jacqueline du Pré, n’avait que 28 ans lorsqu’elle a dû arrêter de jouer, après avoir été diagnostiquée avec une sclérose en plaques. Cette maladie dégénérative du système nerveux central nous a enlevé du Pré bien trop tôt à 42 ans, mais pas avant de lui avoir arraché de manière dévastatrice sa capacité à jouer de son instrument bien-aimé.
La pièce de 1980 de Tom Kempinski s’inspire de l’histoire de du Pré, explorant le chagrin et les tourments ressentis par un musicien renommé qui perd la capacité de jouer. Ici, Stephanie (Tara Fitzgerald) a l’impression de perdre son identité même et son but. Surtout, elle perd les qualités de transport que la musique lui procure dans un monde où les relations, passées et présentes, semblent dominer sa vie.
Stéphanie suit une thérapie à la demande de son mari compositeur, David. Son style combatif et ses manières abrasives envers le Dr Feldmann (Maureen Beattie) sont nés de la peur, du déni et de la colère de ce qu’elle appelle la « paralysie rampante » qui se profile dans sa vie.
Kempinski crée une structure plutôt piétonne pour ce jeu à deux mains, dans lequel nous voyons six séances de thérapie consécutives. Dramatiquement parlant, il y a peu de développement de l’histoire, mais le ton de chaque scène est certainement varié. Au fil des semaines de thérapie, Stéphanie devient de plus en plus belliqueuse et irrationnelle – physiquement, elle se détériore. Alors qu’elle devient de plus en plus conflictuelle, le Dr Feldmann perd patience et, plutôt que d’écouter passivement, se fait une digne adversaire et défie directement son patient.
Entre chaque séance de thérapie, Gabriela Opacka-Boccadoro joue du violon de façon obsédante sur le balcon de l’Oranger. La partition d’Oliver Vibrans est tour à tour urgente et déchirante. Il ancre les procédures à la musique bien plus que les seuls mots de Kempinski. Alors que Fitzgerald entre dans l’espace, elle regarde le violoniste jouer avec passion – peut-être avec un désir sincère, ou peut-être avec une rage furieuse.
La voix pénétrante de Fitzgerald remplit le petit espace de l’Oranger. Sa Stéphanie est obstinée, elle avoue qu’elle « ne s’entend jamais avec personne, par principe ». Elle est également vulnérable et « craint l’impuissance et la dépendance vis-à-vis des autres ». C’est un rôle difficile à exploiter et Fitzgerald ne le gère pas toujours. Ce n’est pas un personnage facile à aimer ou même à sympathiser. Il y a des moments où Fitzgerald s’arrête brillamment alors qu’elle se débat avec ses sentiments et comment elle devrait les exprimer. Ses accès de rage ont cependant tendance à devenir frustrants et inexpressifs.
Le Dr Feldmann de Beattie est calme et assuré et semble être en contrôle total à tout moment. C’est donc encore plus choquant quand Beattie explose elle-même de colère avec brio. C’est un comportement peu probable pour un thérapeute envers son patient, mais c’est tout de même un moment pour retenir votre souffle.
Richard Beecham dirige sa compagnie de deux assez statiquement. Le face-à-face entre thérapeute et patient est accentué, ils passent toute la soirée assis l’un en face de l’autre, à se regarder intensément. Une petite révolution les déplace doucement et presque imperceptiblement à 360 degrés à plusieurs reprises.
Stéphanie croit que « la musique est l’expression la plus pure de l’humanité » et en parle comme quelque chose de presque divin. Quand elle parle de donner son violon, c’est comme si elle avait dû donner son propre enfant. Sa musique la définit et accepter la vie sans cela est presque impossible à supporter pour elle. Mais quand le personnage est aussi dur et la représentation d’elle aussi impitoyable, il est difficile de ressentir beaucoup de sympathie pour elle.
…