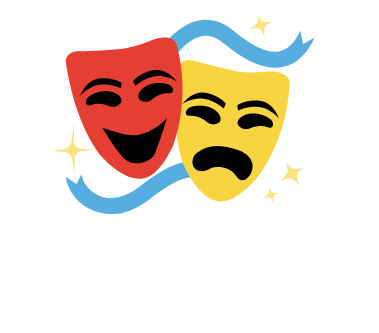Emma Corrin est une actrice très spéciale, avec une capacité à tenir un espace et à attirer l’attention simplement par sa présence. Après des débuts sur scène dans le West End à Anna X l’année dernière, ils reviennent sur la scène londonienne dans une adaptation d’Orlando de Virginia Woolf – une partie qui aurait pu être écrite pour eux, pleine de joie, d’espoir et de sens des possibilités pour l’avenir.
L’époustouflant jeu d’esprit d’un livre de Woolf est une biographie d’Orlando, né homme sous le règne de la reine Elizabeth I, qui sert d’ambassadeur à la cour turque sous Charles II, puis se réveille un jour en femme, celle qui vit pour devenir une écrivaine dans l’Angleterre des années 1920. Écrit sous l’influence de l’histoire d’amour de Woolf avec Vita Sackville-West, c’est à la fois radical et amusant.
Il est aussi, pour l’essentiel, impossible à adapter à la scène puisqu’une grande partie de son plaisir provient de son ton, de la connaissance de soi d’Orlando, de l’esprit de Woolf et de la prose qui s’insinue entre les deux. La version de Neil Barlett, pour le MGC du réalisateur Michael Grandage, décide judicieusement d’imposer une structure différente et quelques blagues supplémentaires, remplissant la scène avec des versions de Virginia, qui tiennent tous les rôles.
Il donne également à Orlando un acolyte omniscient sous la forme de Mme Grimsditch de Deborah Findlay, grommelant d’un ton bourru – et avec un timing comique immaculé – d’avoir à fournir tous les changements de costumes et les commentaires sur les siècles qui changent à mesure qu’ils se précipitent. De cette façon, il préserve toute la compréhension étonnée d’Orlando des limites de la vie d’une femme – incapable d’hériter de son propre domaine, par exemple.
À l’époque victorienne, lorsque Woolf est bien sûr né, le monde se réduit à un seul lit. « Je ne semble pas être capable de sentir mon cerveau », dit Orlando, malheureusement. « Je ne devrais pas m’inquiéter pour ça mon cher », répond Mme G. « Ce n’est pas vraiment la chose faite en ce moment pour une femme. »
Tout est très méta et intelligent. (« Je souhaite changer », dit Orlando. « Serait-ce une transformation métaphorique », rétorque Mme G.) Bartlett complète les différentes époques du scénario par des citations de sources aussi variées que Shakespeare et Some Like It Hot. Le passage des siècles est également magnifiquement marqué par les créations de Peter McKintosh : des rideaux de velours luxuriants se précipitent pour annoncer le 18e siècle, William Morris a conçu un papier peint pour le 19e.
La direction de Grandage est également fluide. Il est brillant pour rassembler les Virginias en cardigan beige autour de la scène, permettant aux qualités individuelles de chacun de briller et de laisser l’action se dérouler avec une emphase facile. Certaines scènes – quand Orlando tombe amoureux d’une princesse russe patineuse dans le grand gel de 1607 – sont évoquées comme par magie, avec l’éclairage de Howard Hudson et la musique d’Alex Baranowski ajoutant à l’ambiance.
Mais malgré tous les soins qui lui sont prodigués, il y a quelque chose d’insaisissable à ce sujet Orlando. C’est comme si Bartlett avait gardé l’intrigue mais perdu l’essence de l’histoire. Vous ne voulez pas une transformation stricte du livre en scène, mais j’espérais quelque chose de plus systématiquement éclairant. En l’état, le sens du sublime n’arrive qu’à la fin, quand Orlando affirme soudain son droit d’être tout ce qu’il rêve et aime.
Corrin, qui s’identifie comme non binaire, saisit le moment, l’ouverture de leur visage et la simplicité de la façon dont ils écoutent et répondent, créant une conclusion d’une puissance émotionnelle édifiante, totalement dans l’esprit de Woolf. Tout au long, c’est une performance fantastique, pleine de détails doux – les épaules se tortillant de dégoût, les yeux écarquillés de découverte – et Corrin fournit le cœur convaincant d’une pièce problématique.
…
…