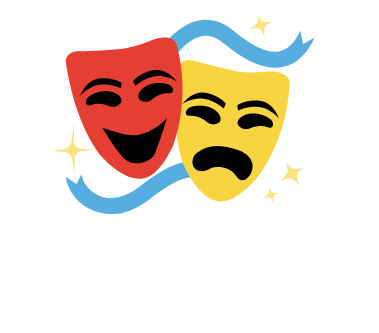Il y a un essai de programme de la réalisatrice et star Adjoa Andoh dans lequel elle décrit comment, en tant que seule enfant noire ayant grandi dans les Cotswolds dans les années 1960 et 1970, elle se sentait complètement étrangère. C’est ce sens de la différence et de l’aliénation qu’elle voulait explorer dans le personnage du plus grand méchant de Shakespeare, Richard III.
Vous pouvez voir son point. Il y a quelque chose de terrifiant dans la façon dont Richard est dessiné dans le texte de Shakespeare, sa difformité physique jouant dans les notions élisabéthaines du mal et son « altérité » étant exploitée – notamment par lui-même – à des fins politiques. Les parallèles sont intrigants et pourraient bien valoir la peine d’être étudiés. Malheureusement, au-delà de l’idée initiale, le concept ne résiste tout simplement pas à un examen sérieux dans cette production criarde et superficielle.
Andoh, un vétéran de la RSC parmi d’autres sociétés, est extraordinaire dans le rôle-titre. Sa performance est excentrique, à la limite de l’excentrique, avec des décisions étranges sur l’endroit où mettre l’accent sur certaines lignes, et même en les donnant à des voix chantantes éthérées invisibles à des moments cruciaux. Ainsi, le monologue d’ouverture emblématique de Richard, « Maintenant, c’est l’hiver de notre mécontentement… », est considérablement dilué car il a déjà été chanté par un chœur hors scène alors que Richard d’Andoh regarde autour de lui d’un air interrogateur.
L’excentricité s’étend également à d’autres rôles, presque tout le monde parlant avec un accent de pays de l’ouest de la morue qui se rapproche dangereusement de Stephen Merchant ou Ce pays-type comédie. Les choses ne sont pas aidées par la conception des costumes de Maybelle Laye, qui habille tout le monde dans le même pyjama de karaté de type Jedi, créant une uniformité terne qui prive les monarques de leur noblesse et les guerriers de leur redoutable. Les personnages se distinguent par des couvre-chefs et des perruques de plus en plus étranges ou même, dans un cas, avec une marionnette, donnant lieu au spectacle bizarre d’un prince dans la tour ventriloque l’autre alors qu’ils discutent de leur sort.
La musique de Yeofi Andoh, tissant des lignes de texte chanté (apparemment au hasard), prouve un autre point de friction. C’est un peu folk, un peu surnaturel, mais rarement mémorable et trop souvent intrusif.
Du côté positif, le décor d’Amelia Jane Hankin offre une toile de fond saisissante, avec un mur incurvé géant encadrant l’action en rose orangé et un tronc d’arbre au centre de la scène créant un point focal. À des moments stratégiques, l’éclairage d’ambiance de Chris Davey projette d’énormes silhouettes sur le mur par derrière, laissant place à des exécutions et des armées stylisées.
Mais le problème fondamental est la décision de peindre Richard comme une sorte de victime des circonstances, plutôt que comme le psychopathe meurtrier de l’imagination de Shakespeare. Le texte ne le soutient tout simplement pas, et il transforme le personnage d’une étude véritablement terrifiante du mal en un exemple moins que crédible de victimisation devenue mauvaise. Cela atteint son apogée dans les derniers instants, lorsque Richard, vaincu au combat, revient à la vie pour chanter une complainte d’apitoiement sur lui-même alors que ses vainqueurs Tudor exécutent une danse de victoire Morris au ralenti.
Toutes mes excuses si c’est un peu un spoiler, mais rassurez-vous : c’est loin d’être l’élément le plus étrange de cette production totalement mystifiante.
…